-
 Vidéo
VidéoLe Roman de la Rose
-
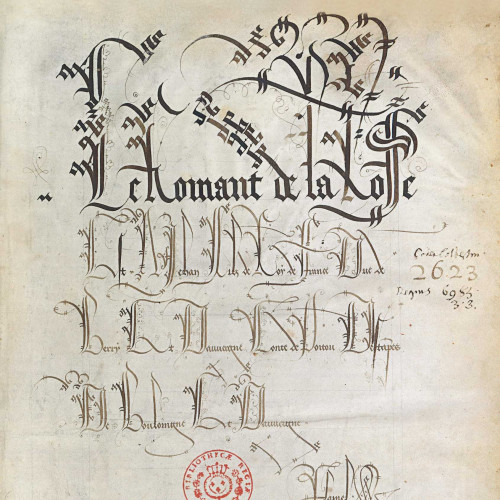 Album
AlbumLe Roman de la rose, un art d'aimer (première partie)
-
 Album
AlbumLe Roman de la rose, un miroir périlleux (deuxième partie)
-
 Album
AlbumLe Roman de la rose, un miroir de l'amour (troisième partie)
-
 Album
AlbumLe Roman de la rose, l'œuvre la plus célèbre du Moyen Âge
-
 Livre à feuilleter
Livre à feuilleterLe Roman de la Rose
-
 Vidéo
VidéoLe Cœur d’amour épris
-
 Album
AlbumLe livre des échecs amoureux
-
 Livre à feuilleter
Livre à feuilleterLe Cœur d'amour épris
-
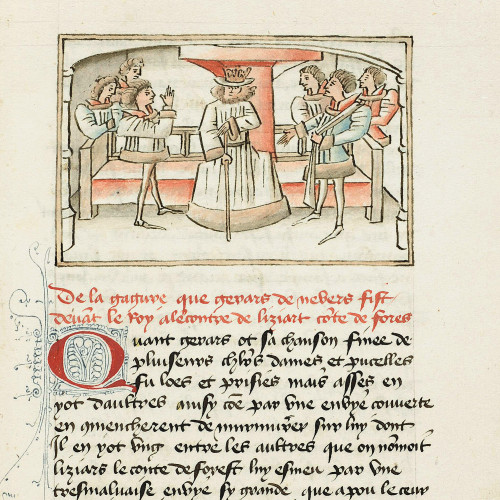 Livre à feuilleter
Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers
Le Roman de la rose, un art d'aimer (première partie)
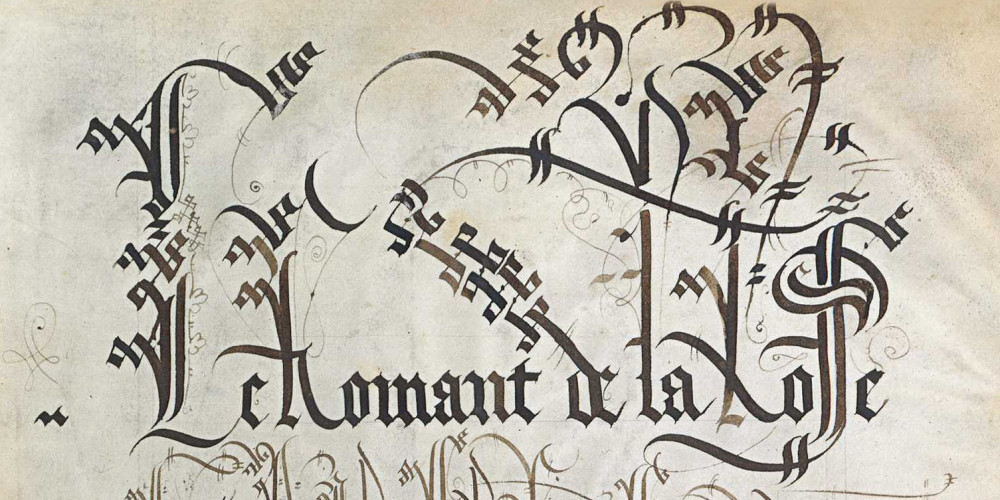




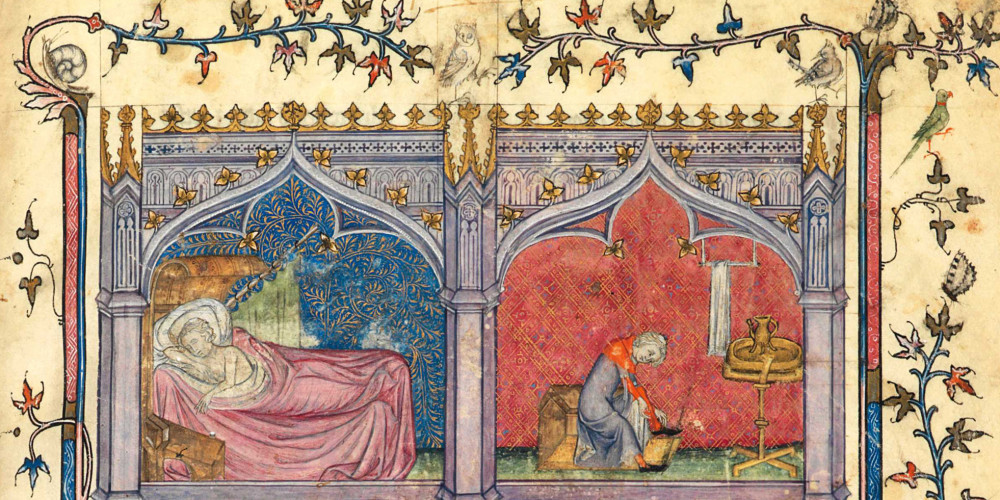
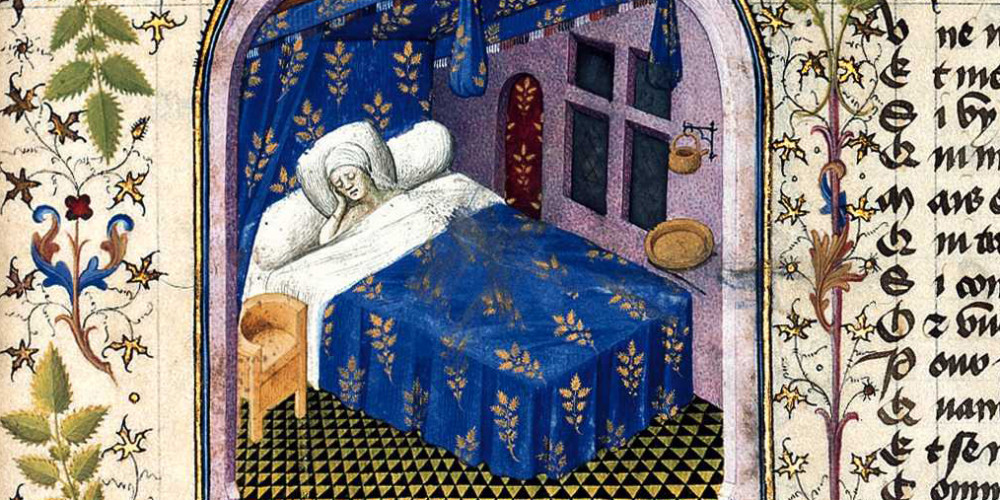






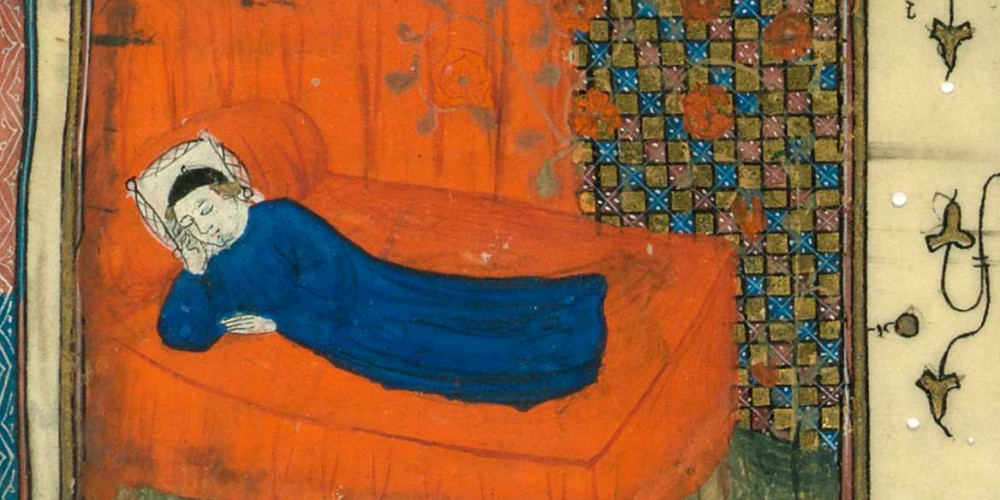
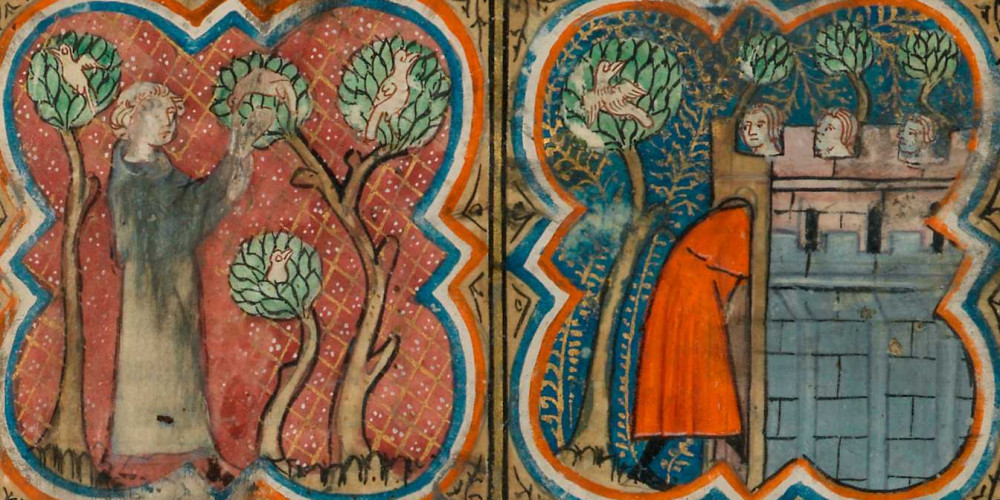






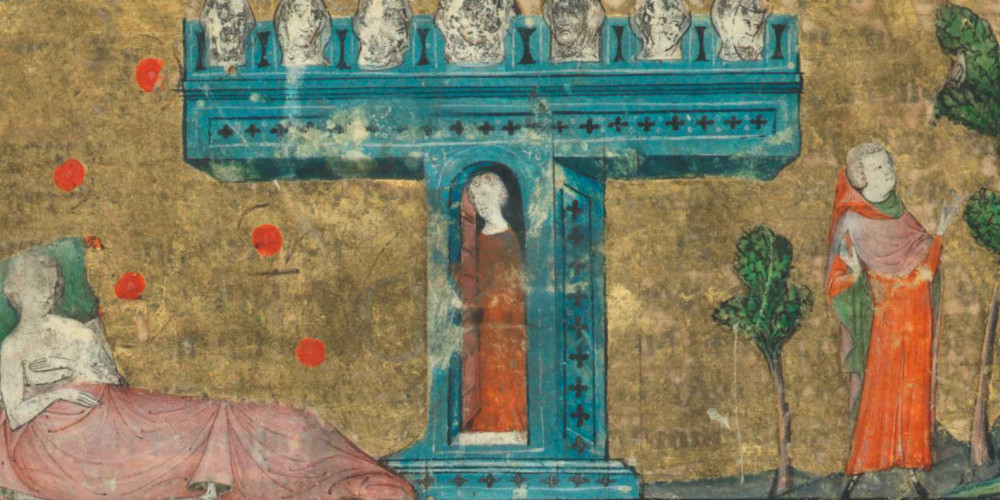


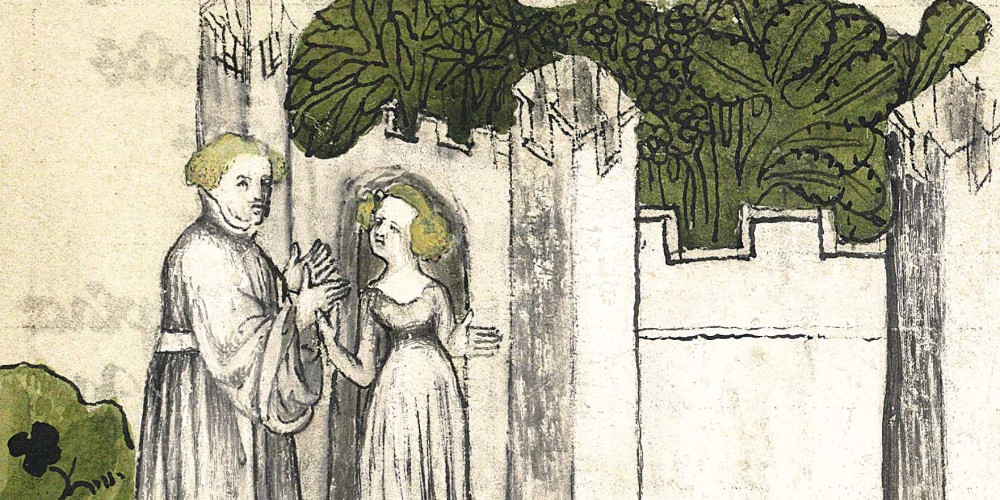



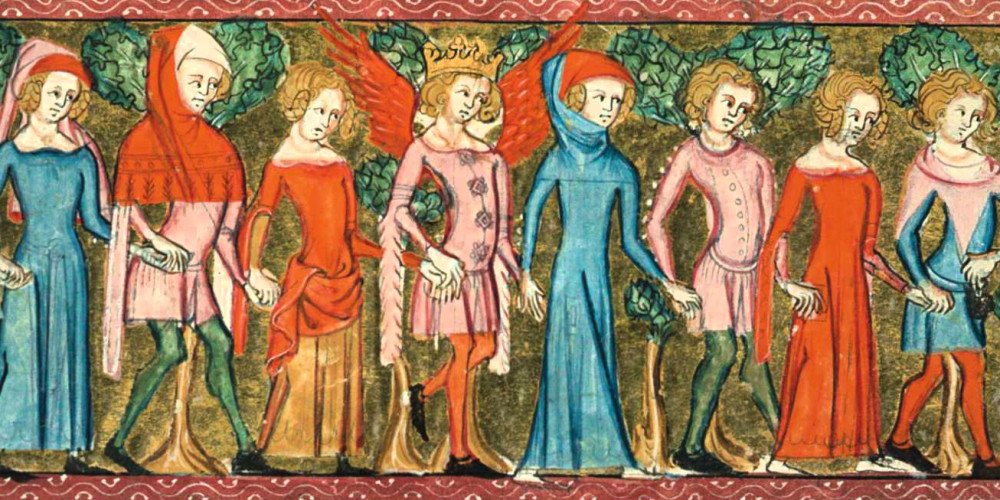


Le Roman de la rose, « Art d’aimer » courtois et érudit, a séduit des générations de lecteurs du 13e au 16e siècle. Tout à la fois délicieusement aimable et misogyne, codifié et subversif, ce long poème traite d’un sujet intemporel : l’amour, ses joies, ses écueils, ses enjeux sociaux et spirituels.
Détail de l’ex-libris du duc Jean de Berry, calligraphié par son secrétaire Jean Flamel, sur l’un des cinq exemplaires manucrits du Roman de la rose lui ayant appartenu.
Le Roman de la rose est un long poème écrit au XIIIe siècle par deux auteurs successifs : Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Prenant la forme d’un songe allégorique, il narre la conquête d’une Rose - une jeune fille - par un jeune homme, l’Amant.
Bibliothèque nationale de France
Le Livre des cleres femmes
Dans cette peinture, exactement contemporaine de la Querelle du Roman de la rose et sans doute inspirée par elle, Christine de Pizan est représentée devant sa table d’étude, courtisée par un amant.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
L’auteur du Roman de la rose écrivant dans son cabinet
Auteur d’une des œuvres les plus fameuses du Moyen Age, la seconde partie du Roman de la rose, Jean de Meun (ou de Meung) est représenté écrivant dans son cabinet. Devant lui, une roue à livres, pupitre tournant qui lui permet de consulter tour à tour différents documents.
© Bibliothèque nationale de France
« Car quant Guillaumes cessera, Jehans le continuera », v. 10591-10592
Suivant très exactement le Roman (v. 10589), les deux auteurs écrivent chacun sur leur pupitre les premiers mots de leurs textes ; à gauche, Guillaume de Lorris inscrit « Mout de gens dient que un songes n’a se fable… »
Bibliothèque nationale de France
Néron faisant éventrer sa mère
Cette œuvre qui débute sous les auspices de la « fin’amor » et se clôt dans une atmosphère dionysiaque, traite de l’amour, ses joies, ses écueils, ses enjeux sociaux et spirituels. Elle aborde des questions sur l’art de la séduction, la crudité du langage, la misogynie, la place de l’amour dans le destin de l’humain qui restent d’une étonnante modernité.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
La quête de l’Amant
Délicate peinture présentant dans un encadrement gothique les quatre étapes traditionnelles de l’entrée en quête : l’amant veille ; il se chausse et se lave ; il longe la claire rivière ; parvenu aux murs du verger merveilleux, il frappe à la porte.
Dans la marge inférieure, un ours et un singe, enchaînés, côtoient un lion et une lionne.
Mots-clés
© BIU Montpellier
Feuillages de rosiers encadrant le premier feuillet d’un manuscrit du Roman de la rose
Des feuilles de rosier qui parsèment le lit du dormeur et encadrent la page de titre entrent en résonance avec le titre du livre. Le manuscrit porte les armes de la famille Du Plessis d’Assé.
Bibliothèque nationale de France
« Reverdie » et amours printanières
Pleine de charme, cette page frontispice unit autour du thème de la nature les deux parties, bien différentes, du Roman de la rose. Au milieu d’un buisson de roses égayé par le chant des oiseaux, le narrateur rêve.
Dans des rinceaux de rosiers, la Vieille invite une jeune fille à profiter des plaisirs de la vie : un corbeau picore un bouton de rose ; un couple est tendrement enlacé.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Le dormeur, entre Amour et Danger
Dans un bel encadrement architectural gothique, le narrateur du Roman de la rose, rêve à la cueillette de la rose. À ses côtés, le dieu d’Amour, couronné et ailé, et Danger, armé d’une massue, figurent les espoirs et les écueils de sa quête.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Guillaume de Lorris sommeillant
Le Roman de la rose est un songe allégorique. Le narrateur raconte comment, en rêve, il est entré dans le jardin où réside le Dieu d’Amour et y est tombé amoureux d’un bouton de rose.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Elégant rosier aux côtés du dormeur.
Elégant rosier aux côtés du dormeur.
Bibliothèque nationale de France
Un buisson de roses
Un buisson de roses semble naître du lit où l’amant-clerc rêve, à demi endormi ; mais Danger, avec sa massue, veille. Cette miniature, qui introduit les plus anciens manuscrits, s’inspire de l’arbre de Jessé. On peut l’interpréter ainsi : contrairement au propos de Jean de Meun, la procréation n’est pas libre, mais reste soumise aux interdits, particulièrement ceux de l’Église.
Bibliothèque nationale de France
Oiseuse
A droite, Oiseuse se pare au faîte des murs du verger. La forme arrondie du jardin fait écho à celle de son miroir, évoquant ainsi l’ambition spéculaire du Roman de la rose.
Bibliothèque nationale de France
Roman de la rose
A gauche, le dormeur et le rosier. A droite, le dormeur se voit, en songe, se lever et se laver les mains ; il est prêt à vivre son initiation amoureuse.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Roman de la rose
Le songe se déroule au printemps, temps des amours et du réveil de la nature. Le songeur est un tout jeune homme, enclin à se laisser entraîner dans une aventure amoureuse. Après avoir quitté la ville et folâtré dans une nature radieuse, le narrateur aborde un jardin cerné de hauts murs, d’où s’échappe une délicieuse musique.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Pelerinage
Sortant de chez lui, après s’être lavé les mains, le rêveur, posté sur un tertre d’où coule une rivière, écoute, fasciné, le chant des oiseaux. Il se rafraîchit le visage dans l’eau claire, et découvre, sur les murs crénelés qui entourent le Verger, les figures hostiles à l’amour, en particulier Papelardie, lisant son psautier, et Pauvreté, en haillons.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
L’amant endormi, se levant et se chaussant, se lavant, sortant de sa chambre et arrivant devant le jardin de Déduit
Cette enluminure illustre les prémices du récit du Roman de la rose : le narrateur, en songe, se lève, s’habille et chemine jusqu’à un mystérieux verger, ceint de hauts murs sur lesquels sont représentées des figures anti-courtoises
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Le narrateur découvre le jardin
Sur les murs extérieurs du jardin sont représentées dix figures allégoriques représentant tout ce qui s'oppose à l'amour : Vieillesse, Tristesse, Pauvreté, Avarice... La belle portière du jardin, Oiseuse, annonce au narrateur que ce jardin est la propriété de Déduit, le divertissement, et le séjour du Dieu d’Amour.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Pauvreté
Pauvreté, pieds nus et vêtue de haillons, grelotte, recroquevillée sur elle-même.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Vieillesse
Courbée par les ans, Vieillesse s’avance sur ses deux cannes. L’illustrateur n’a pas figuré les oreilles moussues et la bouche édentée si joliment décrites par Guillaume de Lorris (v. 355) : « Les oreilles avoit mossues / Et toutes les denz si perdues / Qu’ele n’en avoit mes que une. »
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Tristesse
Les cheveux défaits, Tristesse se lamente ; elle déchire sa robe, qui découvre une poitrine décharnée.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Le mur du Verger de Deduit
Suivant exactement le texte, l’illustrateur a figuré, dans une composition originale, les visages des vices apparaissant au sommet des murs crénelés du Verger, dont Oiseuse garde la porte (v. 129-133) :
Quant j’oi. i. pou avant alé,
Si vi un vergier grant et lé,
Tout clos de haut mur bataillié
Portrait et dehors entaillié
A maintes riches escritures.
(Après avoir parcouru un bout de chemin, j’aperçus un verger vaste et étendu, entièrement clos d’un haut mur crénelé, qui à l’extérieur était peint et sculpté de nombreuses et superbes représentations.)
Mots-clés
Largesse
Oiseuse, comme son nom l’indique, n’a d’autre occupation que le soin de sa toilette. Allégorie de la séduction féminine, elle convainc le narrateur de franchir le seuil du jardin d’Amour.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Oiseuse et son miroir
Oiseuse est ici dotée de l’attribut que Guillaume de Lorris lui a conféré : le miroir, à la fois symbole du pouvoir de séduction féminin et emblème médiéval du savoir. Le miroir a une signification complexe au Moyen Âge : il peut être fidèle ou trompeur ; il renvoie au corps et au désir mais aussi à Dieu, car le monde créé est un reflet du divin.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Oiseuse devant la porte du jardin
La blonde et belle Oiseuse garde l’entrée du luxuriant Jardin de Déduit.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
L’amant entrant dans le jardin de Déduit, accueilli par Oiseuse
La portière du jardin, Oiseuse, se mire dans son miroir.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Carole et musiciens
Dans le jardin, s’ébattent en une farandole (la carole) les allégories de l’amour courtois : Richesse, Beauté, Franchise, Jeunesse ainsi que le Dieu d’Amour et son double, Doux Regard, symbole du « coup de foudre », de la naissance de l’amour.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Carole
La scène de danse de la carole, à laquelle se livrent les allégories de la courtoisie autour du dieu d’Amour, est emblématique de l’atmosphère enchanteresse créée par Guillaume de Lorris. On voit ici Doux Regard armé d’une flèche. Le narrateur, un peu à l’écart, se penche sur les eaux de la fontaine de Narcisse.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
La carole
Portées sur une longue frise horizontale, les allégories de la courtoisie dansent la carole-farandole, en se tenant par la main avec, en leur centre, le dieu d’Amour, ailé et couronné, accompagné de Liesse, « ’anvoisie [l’enjouée], la bien chantanz ».
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Jeunesse et son ami
Dans une prairie où courent des lapins, Jeunesse et son ami se tiennent enlacés (v. 1288-1297) :
Les queroles ja remanoient
Car tuit li plusor s’en aloient
Ou lor amies ombroier
Souz ces arbres por donoier.
Dieux com avoient bone vie !
Fous est qui n’a d’autel envie :
Qui autel vie avoir porroit,
De meillor bien se sofferroit,
Qu’il n’est nus graindres paradis
Qu’avoir amie a son devis.
(Les caroles déjà se terminaient, car la plupart des danseurs allaient chercher avec leurs amies l’ombre pour conter fleurette. Mon Dieu ! quelle belle vie ils menaient ! Bien fou celui qu’i n’a envie d’une telle existence ! Il se passerait d’un bien plus grand, celui qui pourrait jouir d’une telle vie, car il n’existe pas de plus grand paradis que d’avoir une amie à son gré.)
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Franchise
Vêtue d’une simple robe blanche, Franchise, un claquoir à la main danse avec un jeune noble, celui-ci paraît assis (v. 1188-1196) :
Après tous ceus se tint Franchise
Qui n’iere pas brune ne bise,
Ainz ere plus blanche que nois,
Si n’ot mie neis d’Orlenois […]
S’ot les chevous blonds et lons
Et fu simple com. i. colons.
Le cuer ot douz et debonere…
(Après tous ces gens se tenait Franchise, qui n’avait pas le teint brun ou sombre, mais était plus blanche que neige, et son nez n’était pas à la façon d’Orléans… Elle portait aussi des cheveux blonds et longs, et sa modestie était celle d’une colombe. Elle avait le coeur doux et bon…)
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
